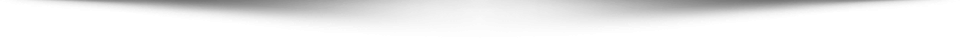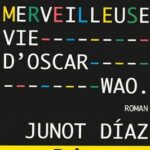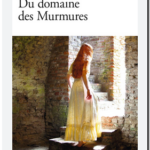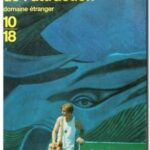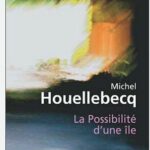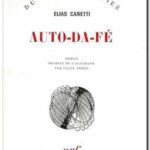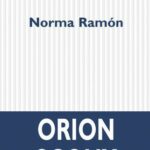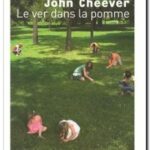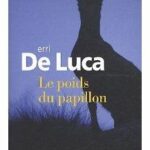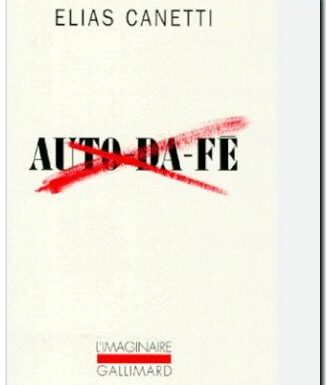
Il s’agit du seul roman d’Elias Canetti, prix Nobel de littérature en 1981. Un seul roman, mais quel roman ! Il est difficile d’en raconter l’histoire (mais l’importance de l’histoire n’est-elle pas secondaire ? N’est-ce pas la particularité d’un mauvais livre que de se réduire à sa seule intrigue ?), car il n’a pas vraiment d’unité. Auto-da-fé est un livre éclaté. Le sinologue Peter Kien en est certes le personnage principal, mais de nombreux chapitres sont exclusivement consacrés aux autres protagonistes du livre, sans que cela soit essentiel au déroulement des mésaventures de Kien. Pour ceux qui ne connaissent pas le livre et qui aimeraient savoir de quoi il s’agit, disons que Auto-da-fé raconte principalement les déboires d’un savant dont la vie est consacrée à l’étude et qui ne connaît de passion que celle des livres. Son appartement est une immense bibliothèque composée de 25000 volumes et Kien ne peut sortir de chez lui – et il ne le fait qu’une heure par jour, le matin – sans emporter quelques livres. Il est considéré comme une sommité mondiale, même s’il refuse de participer au moindre colloque. Il vit satisfait, jusqu’à son mariage (serait-ce le cas de tous les hommes ?) avec sa bonne qui se révèle être une personne abjecte, prête à tout pour de l’argent, même à vendre les livres de son époux lorsqu’elle sera parvenue à le chasser de chez lui. Thérèse, la bonne devenue Mme Kien, est l’un des quelques personnages qui vont entrer dans la vie de Kien pour la lui gâcher. Il y a aussi Fischerle, nain escroc passionné d’échec, qui va prendre Kien sous sa vorace protection pour mieux le voler et Benedikt Pfaff, son concierge, chez qui il trouvera refuge, un ancien policier dont la violence est le seul mode d’expression : sa manière d’aimer ou de détester, comme l’ont appris sa femme et sa fille qui sont d’ailleurs mortes sous ses coups. Dans l’étude qu’il consacre à ce livre dans Vérité et mensonge, Vargas Llosa affirme que l’immense culture de Kien « dresse une muraille d’incommunicabilité entre le monde et lui ». Vargas Llosa, bon humaniste, en est désolé. La culture n’est-elle pas ce qui réunit les hommes, ce qui leur permet de se rencontrer ? Peut-être… Il me semble plutôt que la culture isole profondément, parce que la plupart des hommes sont stupides, ignares et mesquins. Celui qui pense est nécessairement seul, même lorsqu’il est entouré. Les autres lui sont absolument étrangers. Kien est seul parmi les hommes parce qu’il est en compagnie de ce qui transcende la sécularité :
« Tant que sa tête était occupée à soupeser, classer, coordonner des faits choisis, des renseignements et des conceptions, l’utilité de sa solitude lui semblait certaine. Vraiment solitaire, seul avec lui-même, il ne l’était jamais. C’est précisément ce qui fait le savant : il est seul pour être avec le plus de choses possibles en même temps. »
L’homme cultivé est Atopon. Ce terme se retrouve dans différents dialogues de Platon pour caractériser Socrate qui l’accepte toujours volontiers alors qu’il a habituellement tendance à refuser tout qualificatif. Atopon est généralement traduit par « atypique », « original », ce qui est effectivement son sens. Hélas, l’originalité est aujourd’hui si édulcorée – tout le monde n’est-il pas si original que la véritable originalité serait de ne pas l’être ? – qu’une telle traduction est insuffisante. Atopon signifie littéralement « sans lieu » : est Atopon celui qui est si singulier qu’il n’est pas « dedans », pas dans le lieu, pas dans l’action, pas dans le flux de la vie quotidienne. Les préoccupations de l’atopon ne sont pas celles de n’importe qui, les préoccupations de Kien ne sont pas celles de Thérèse. Celle-ci vit dans l’obsession de l’avoir : l’argent, les meubles, la propriété, la position sociale (une fois mariée, elle méprise les domestiques) alors que Kien vit dans l’obsession de l’être, ses livres sont son seul univers (« son monde, c’était sa bibliothèque.») et il n’a, pour tout mobilier, qu’une chaise, un bureau et un divan, c’est-à-dire le strict nécessaire pour travailler et se reposer (mais se reposer uniquement afin de mieux travailler !). Il n’est donc pas étonnant qu’il se laisse si négligemment dépouiller de sa fortune par tous ceux qu’il croise ! Tel est d’ailleurs ce que lui reprochera son frère Georges, gynécologue devenu psychiatre (un véritable psychanalyste ! ce n’est pas pour rien qu’il ne veut surtout pas soigner ses patients !), son sauveur et son involontaire bourreau :
« Tu ne vois pas ce qui se passe autour de toi. Tu n’as pas le souvenir de tes propres expériences. »
Elias Canetti, Auto-da-fé. Gallimard, L’Imaginaire. 14.5 euros. 616 pages.