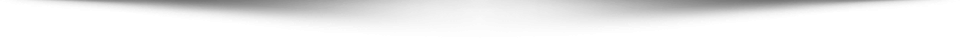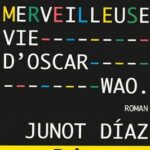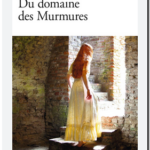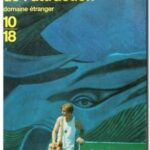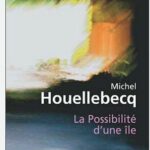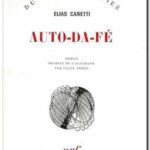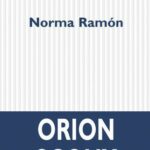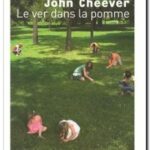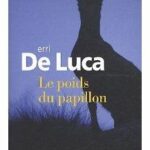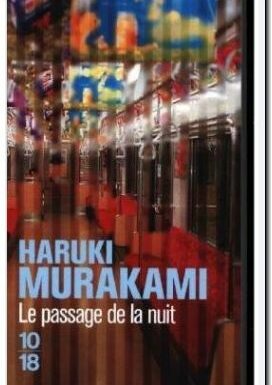
L’univers de Murakami
Ce qu’il y a d’extraordinaire chez Murakami, c’est cette capacité à faire de nous de simples spectateurs, comme si on regardait un écran de télévision. Sans possibilité de zapper. Notre œil devient « caméra suspendue en l’air », nous voyons tout, de notre regard qui forme un point de vue idéal, sans possibilité d’intervenir, puisque c’est la nuit, et elle seule, qui pourra influencer sur le destin des personnages. « La nuit possède une horloge différente ».
Cette caméra est flexible, elle change les prises de vue, passe à travers les murs et les portes, peut se positionner n’importe où, même au-dessus de l’atmosphère, pour nous permettre de contempler ce spectacle cinématographique qu’est la nuit. L’auteur nous ajoute même une bande originale des plus douces, du jazz, de la musique classique, une répétition de musiciens.
L’auteur japonais abolit la frontière entre réel et irréel, rêve et réalité, mensonge et vérité. La nuit, tout devient possible. Qu’Eri passe un écran de télévision, et se matérialise de l’autre côté, ou que Mari se regarde dans le miroir qui retient son reflet, on évolue dans un monde où il n’y a plus de barrières, puisque notre œil est caméra. La frontière entre les heures devient de plus en plus indistincte, avec les chapitres qui s’accélèrent à la fin, celle entre les différents mondes s’amenuise.
Superficialité urbaine
Central dans le roman, l’un des décors les plus significatifs est le love-hotel, dirigé par une ancienne catcheuse, où les hommes viennent chercher un peu de réconfort, ou les couples s’amuser quelques heures. L’Alphaville, comme inspiré du film de Godard, ce monde où les sentiments sont inhibés, où la superficialité triomphe du romantisme.
A la lecture de Le Passage de la nuit, on a également cette impression de manque de profondeur. Il est des personnages qui auraient pu se rencontrer, mais non. Il y a des anecdotes dont on ne saura rien, des confidences faites qu’à moitié. Les théories les plus audacieuses, comme celle où Takahashi compare le système judiciaire à un gigantesque poulpe, faisant référence au Procès de Kafka, côtoient les discours terre-à-terre sur la gastronomie et la santé.
A la fin, Tokyo-nuit s’apprête à se réveiller, à redevenir un gigantesque monstre urbain, seulement traversé par le passage de la nuit mais « la lumière abondante du matin nettoie le monde de fond en comble ».
Un roman cinématographique en forme de conte initiatique, où l’onirisme côtoie une réalité plus sombre. Après le générique, on a un mal fou à se décoller de son siège
Haruki Murakami, Le passage de la nuit, 10|18 éditions, 2008, 230 pages.