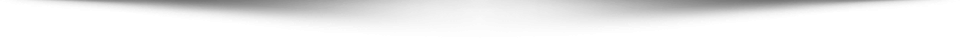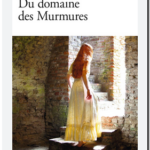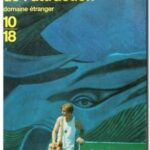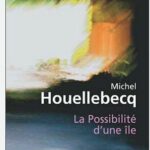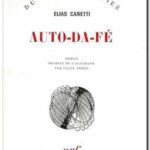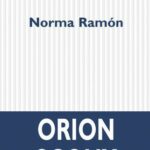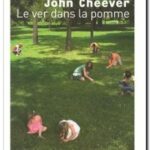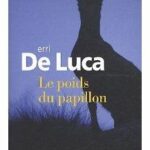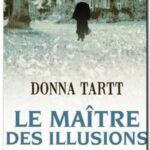Prenons l’exemple de la surdité. Dans l’Égypte et la Perse antique, les sourds étaient considérés comme des « favoris des dieux », des « êtres privilégiés du ciel ». Une forme de culte leur été même voué. C’est tout le contraire de la pensée occidentale, surtout au moyen âge, où l’on voyait en la personne sourde, des « êtres privés d’âme », des « esprits qui ne pouvaient être doués de raison » et on alla même jusqu’à leur contester leur appartenance à l’humain. Si les mentalités ont changé, se pose toujours la question du rapport de le handicap à la normalité, à la différence.
Etre différent est-ce être anormal ? Si l’on considère à nouveau l’exemple de la surdité, ce qui va marquer la différence entre une personne sourde et une personne entendante, c’est à première vue, le petit appareil situé sur l’oreille. Stigmatisée par ce contour auditif il ne fait plus aucun doute que nous avons face à nous une personne sourde. Alors en quoi ce stigmate intervient dans la notion de normalité ? prenons le témoignage de Jérôme qui est aujourd’hui âgé de 18 ans et qui se rappelle sa scolarité en primaire : « j’aurais préféré ne pas être appareillé parce qu’avant je me considérais normal, il n’y avait pas de différences, j’arrivais à suivre … être normal c’est parler avec tout le monde … j’étais plus ouvert que maintenant … quand j’ai eu mes appareils tout a changé, il y a eu des moqueries, les autres enfants disaient « regarde le c’est un mongol » … lorsque je posais mes appareils les autres disaient : « c’est dégueulasse ! » … j’étais différent parce que j’étais le seul à avoir çà … alors je me suis dis eux c’est normal ils sont habitués à entendre ils ne comprenaient pas pourquoi j’avais çà, ils préféraient se moquer plutôt que de comprendre pourquoi j’avais çà … longtemps on m’a trouvé bizarre ». Ce témoignage, saisissant, pose bien le rapport normal/anormal lié au fait de porter des prothèses auditives. Ce stigmate infligé aux sourds dés leur plus jeune âge sans jamais leur demander leur avis. Pourquoi ? Vouloir tant vouloir appareiller les sourds ?
Pour les rendre « normaux », c’est-à-dire entendre comme un entendant ? Entendre normalement ? Ou pour nier leur différence ?
Références
DOUGLAS Mary De la souillure : Essais sur les notions de pollution et de tabou, Editions La Découverte 2008
GOFFMAN, Erving : « Stigmate, les usages sociaux des handicaps », Les éditions de minuit, Paris, 1975.
BECKER, S. Howard : « Outsiders, Etudes de sociologie de le déviance » éd. Métailié, Paris, 1985.
PADDEN, Carol & HUMPHRIES, Tom. Deaf in America, voices from a culture, Harvard, 1988.