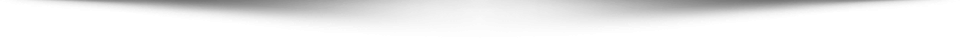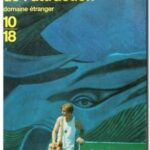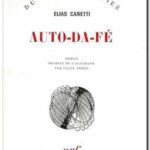L’engagement politique n’est plus, il faut le repenser. La vie n’est plus, les gens sont des “ectoplasmes”, des fourmis au service d’une administration à l’aveuglement absurde, héritage toujours présent de la période fasciste.
Avec un ton interactif, donnant l’impression extraordinaire que Bianciardi construit son récit en fonction des réactions de son lecteur, ‘La Vie aigre’ offre quelques passages inoubliables d’absurdité. Absurdité qui trouve son paroxysme lorsque le héros se fait arrêter parce qu’il marche seul, lentement, en s’arrêtant et, qui plus est, “sans cravate”. Flâner conduit à la prison. Les diatribes sur le sexe omniprésent, ou plutôt son ombre, ou l’immersion dans un centre commercial que l’on croirait sorti des ‘Temps modernes’ de Chaplin, tracent les contours d’un monde mécanique et orwellien, sans goût ni odeur, sans humanité ni sentiments, où les gens ne vous parlent que si vous avez de l’argent à dépenser.
Une vie aigre, troublante, qui n’est pas sans rappeler la nôtre, 45 ans plus tard.