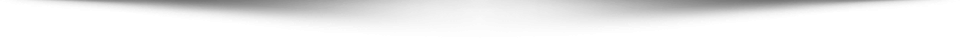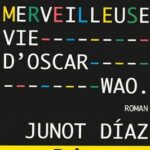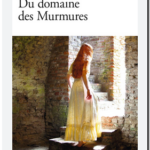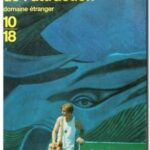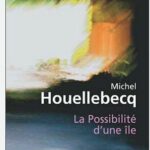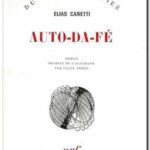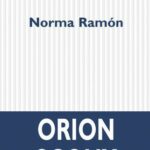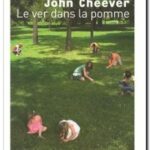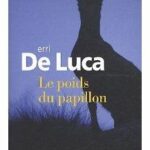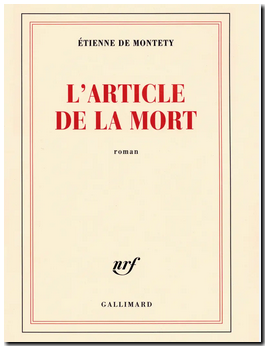
Il y a du Schöndorfer dans cette façon de raconter. Moreira, journaliste, responsable dans son journal des nécros, travaille sur l’article qui sortira normalement au décès de Charles-Elie Sirmont, ancien secrétaire d’État, figure de l’humanitaire courageux qui s’est exposé à Beyrouth, à Dubrovnik, partout où la politique semblait vaine devant la guerre si les politiques ne s’exposaient pas eux-mêmes. Atteint d’un cancer, l’homme est à l’article de la mort. Pour Moreira, il y a urgence.
Homme d’engagement et de conviction, donc. Et c’est là qu’Étienne de Montéty rejoint Schöndorfer – on pense au film L’Honneur d’un capitaine. Moreira cherche la faille, le détail où se cacherait le diable, qui nous emmène dans la guerre d’Algérie, aux pires moments où les SAS sont finalement dissous… par l’Administration française ! « Personne ne soupçonnait que la vie publique de Sirmont prenait naissance en Algérie, sur un coup de panique. […] Il avait fait un choix et avait passé le reste de sa vie à le regretter. » Faut-il croire, comme Moreira, que « tout être est multiple » ? Or, on n’écrit pas une nécrologie sur une faille. Mais on en a besoin pour l’écrire.
La carrure de Sirmont, sa trajectoire dans la Vème République, fait de l’Article de la mort un roman à clefs. Montety raconte des faits réels et y mêle des noms pour déjouer les suppositions du lecteur. Car en Sirmont, il y a du Jean-François Deniau, du Jean d’Ormesson, du Malraux, du Bernard Henri Lévy : « Transformer un épisode, somme toute anecdotique, en un événement central, lui donner valeur de symbole expliquant, mieux qu’un long récit, la Guerre du Liban. Donner l’illusion qu’on a été au cœur de l’histoire et qu’on s’autorise à délivrer modestement la quintessence de ce qu’on a vécu. Tout un art. » Il fut sans doute l’un des premiers à transformer une rencontre en camps du Drap-d’or : « Sirmont raisonnait en stratège. Il analysait la situation en termes de besoin : pour nous, besoin de notoriété ; pour la presse, besoin d’émotions à offrir. C’était très nouveau à l’époque, ce discours. »
Parallèlement au portrait qui se précise au long du roman, Étienne de Montety décrit la stature et le quotidien et les doutes et la solitude du journaliste. Il en fait l’éloge sans grandiloquence. Moreira n’est ni un justicier, ni un flic, ni un détective, ni un redresseur de tords : sa démarche comporte un peu tout cela à la fois, mais il reste simplement journaliste : « Il allait enquêter pour être en mesure, le jour venu, de publier un texte de dix ou douze feuillets. » « Paparazzi de l’âme » comme le dit un avocat assez désagréable au cours d’un dîner pénible où Moreira « en prend plein la gueule » ?
Comme si la nécrologie exprimait une époque, le travail de Moreira passe aussi par l’observation, l’auscultation de son temps. Qu’est-ce qui suscite aujourd’hui l’estime générale qu’on appelle héroïsme ? « Et si notre époque demandait des héros, quand bien même ils seraient des imposteurs ? Elle est revenue des maîtres à penser et demande aux hommes d’être les acteurs de leur propre geste. » Le lecteur de journaux veut rêver et croire encore aux colifichets de la célébrité. Il a besoin de héros et en demande : « Ils participent à la mise en scène qui est devenue une façon d’informer. S’il n’y a pas d’histoire, il n’y a pas d’info. […] Notre émotion collective l’exige. […] Ce qu’on veut, c’est qu’il donne un visage au bien. » Comprenons bien, d’après Étienne de Montety, que si les héros se fabriquent dans la presse, ce n’est pas la presse qui fabrique les héros. La frontière est parfois mince. Sirmont aurait réussi son numéro d’équilibriste si la rigueur (et la passion) de Moreira n’avait pas pris le dessus. D’un article sur un mort, on comprend le paysage automnal d’une époque, d’une société malade, parce qu’elle ne croit plus en la miséricorde.
Un premier roman (et ç’en est un) a le mérite ou le défaut de vouloir trop en dire. Son auteur s’y révèle. Étienne de Montety n’échappe pas à la règle. S’expriment pêle-mêle : sa passion du métier, ses auteurs (Malraux, Bossuet, de Gaulle, Loti et toute la bibliothèque verte de son enfance), son respect de la religion (« C’est quand même beau, la liturgie, ça aide à supporter la mort »), son sens de l’amitié et de la solitude… Sans doute aurait-on voulu qu’il parlât plus directement, sans les masques un peu convenus du roman à clef où bien des allusions tiennent lieu de propos. Il n’empêche qu’il s’en dégage une fraîcheur qui l’emporte sur la fausse innocence. Et c’est réussi
Homme d’engagement et de conviction, donc. Et c’est là qu’Étienne de Montéty rejoint Schöndorfer – on pense au film L’Honneur d’un capitaine. Moreira cherche la faille, le détail où se cacherait le diable, qui nous emmène dans la guerre d’Algérie, aux pires moments où les SAS sont finalement dissous… par l’Administration française ! « Personne ne soupçonnait que la vie publique de Sirmont prenait naissance en Algérie, sur un coup de panique. […] Il avait fait un choix et avait passé le reste de sa vie à le regretter. » Faut-il croire, comme Moreira, que « tout être est multiple » ? Or, on n’écrit pas une nécrologie sur une faille. Mais on en a besoin pour l’écrire.
La carrure de Sirmont, sa trajectoire dans la Vème République, fait de l’Article de la mort un roman à clefs. Montety raconte des faits réels et y mêle des noms pour déjouer les suppositions du lecteur. Car en Sirmont, il y a du Jean-François Deniau, du Jean d’Ormesson, du Malraux, du Bernard Henri Lévy : « Transformer un épisode, somme toute anecdotique, en un événement central, lui donner valeur de symbole expliquant, mieux qu’un long récit, la Guerre du Liban. Donner l’illusion qu’on a été au cœur de l’histoire et qu’on s’autorise à délivrer modestement la quintessence de ce qu’on a vécu. Tout un art. » Il fut sans doute l’un des premiers à transformer une rencontre en camps du Drap-d’or : « Sirmont raisonnait en stratège. Il analysait la situation en termes de besoin : pour nous, besoin de notoriété ; pour la presse, besoin d’émotions à offrir. C’était très nouveau à l’époque, ce discours. »
Parallèlement au portrait qui se précise au long du roman, Étienne de Montety décrit la stature et le quotidien et les doutes et la solitude du journaliste. Il en fait l’éloge sans grandiloquence. Moreira n’est ni un justicier, ni un flic, ni un détective, ni un redresseur de tords : sa démarche comporte un peu tout cela à la fois, mais il reste simplement journaliste : « Il allait enquêter pour être en mesure, le jour venu, de publier un texte de dix ou douze feuillets. » « Paparazzi de l’âme » comme le dit un avocat assez désagréable au cours d’un dîner pénible où Moreira « en prend plein la gueule » ?
Comme si la nécrologie exprimait une époque, le travail de Moreira passe aussi par l’observation, l’auscultation de son temps. Qu’est-ce qui suscite aujourd’hui l’estime générale qu’on appelle héroïsme ? « Et si notre époque demandait des héros, quand bien même ils seraient des imposteurs ? Elle est revenue des maîtres à penser et demande aux hommes d’être les acteurs de leur propre geste. » Le lecteur de journaux veut rêver et croire encore aux colifichets de la célébrité. Il a besoin de héros et en demande : « Ils participent à la mise en scène qui est devenue une façon d’informer. S’il n’y a pas d’histoire, il n’y a pas d’info. […] Notre émotion collective l’exige. […] Ce qu’on veut, c’est qu’il donne un visage au bien. » Comprenons bien, d’après Étienne de Montety, que si les héros se fabriquent dans la presse, ce n’est pas la presse qui fabrique les héros. La frontière est parfois mince. Sirmont aurait réussi son numéro d’équilibriste si la rigueur (et la passion) de Moreira n’avait pas pris le dessus. D’un article sur un mort, on comprend le paysage automnal d’une époque, d’une société malade, parce qu’elle ne croit plus en la miséricorde.
Un premier roman (et ç’en est un) a le mérite ou le défaut de vouloir trop en dire. Son auteur s’y révèle. Étienne de Montety n’échappe pas à la règle. S’expriment pêle-mêle : sa passion du métier, ses auteurs (Malraux, Bossuet, de Gaulle, Loti et toute la bibliothèque verte de son enfance), son respect de la religion (« C’est quand même beau, la liturgie, ça aide à supporter la mort »), son sens de l’amitié et de la solitude… Sans doute aurait-on voulu qu’il parlât plus directement, sans les masques un peu convenus du roman à clef où bien des allusions tiennent lieu de propos. Il n’empêche qu’il s’en dégage une fraîcheur qui l’emporte sur la fausse innocence. Et c’est réussi
L’ARTICLE DE LA MORT, Étienne de Montety Gallimard, 298 p., 18,50 € (octobre 2009)