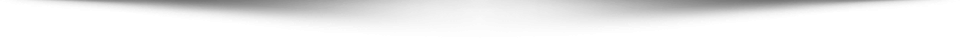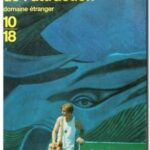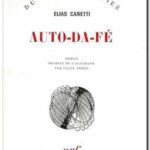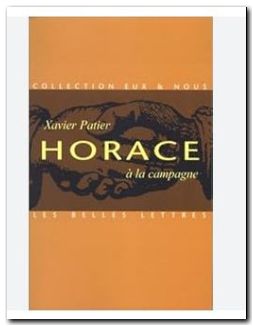
Horace, le poète latin, bien sûr. Il me tardait de lire cet essai. Mais… habent sua fata libelli. À peine paru, aussitôt détruit dans l’horrible incendie de l’entrepôt des Belles Lettres, d’où partirent en fumée des « Budé » par centaines de milliers. Pour en appeler de ce destin mort-né, la « petite vermillon » de la Table Ronde nous rend ce texte, et c’est un bonheur. Pour moi le même bonheur jadis éprouvé à la lecture du Virgile de Brasillach, et de son Corneille. Même vivacité, même liberté d’esprit et de plume, même affranchissement de la patine érudite, même présence au lecteur.
Par formules piquantes, qui feraient de si bons sujets de dissertation… : « Une autobiographie ne nous en apprend pas plus sur un auteur qu’un seul de ses romans, s’il est grand. » « À tout prendre, mieux vaut un écrivain sans œuvre que l’imposture d’une œuvre sans écrivain ».
Par images frappantes : « À trente ans, nous devons prendre une option météo pour le voyage du grand large ; certains optent pour la voile quand d’autres décident de ramer. »
Par fausses bonnes idées : « Il existe deux races d’écrivains. La première, qui est celle de Mauriac ou de Proust, idolâtre son enfance. Elle est composée d’auteurs qui puisent tout en eux-mêmes. Leur œuvre descend de plus en plus profond, comme un forage pétrolier. La seconde, qui est celle de Malraux ou de Kessel, déteste la sienne. Ces écrivains-là se sont coupés de la source première ; il leur faut voyager. Leur œuvre s’étale de plus en plus, comme une flaque.» Toujours ce classique besoin des critiques de classer l’inclassable. Et toujours le même échec, avoué par Patier : « Où situer Horace ? Avec les deux justement. Son génie est d’appartenir aux deux clans… »
Par savoureuses actualisations : « Horace, à l’université d’Athènes, se trouve dans la situation d’un khâgneux de province qui intègrerait la rue d’Ulm en 1990 : trop tard ! Il fallait faire Polytechnique sous Carnot, Normale sous Bergson, l’ENA sous Debré et l’université d’Athènes sous Aristote. Après… » Et celle-ci encore, à propos des traducteurs d’Horace, qui nous ramène au Tour que nous venons de quitter : « Tous les plus grands tentèrent leur chance en alexandrins comme les cyclistes font le Ventoux, parfois avec bonheur et dans la roue d’un autre, comme Boileau derrière Malherbe, ou avec un peu de raideur et en danseuse, comme Leconte de Lisle qui, avec Horace, tirait un braquet trop gros pour ses mollets chétifs et acheva les dernières épodes en état de perdition. »
Par implication personnelle. On pourrait en choisir dix exemples : « Agaçant travers de ramener les choses à moi », dit Patier. En l’occurrence, felix culpa ! « Comme Régis Debray le dit à propos de lui-même, ces excellents jeunes gens de l’entourage de Brutus sont ¢¢républicains comme on était monarchiste au XIXe siècle¢¢ — et j’ai bien envie d’ajouter comme on est gaulliste aujourd’hui. Trop tard ! Ils trépignent sur le quai de l’Histoire quand le train est déjà loin et la gare sinistre. Ils finissent au buffet pour noyer entre copains leur spleen en s’étonnant de leur prodigieuse et stérile lucidité. J’ai connu ça, à Brive. » Étonnant le trop tard chez Patier : la khâgne, la politique. Reste au moins la chasse à courre. Et une foi dont la proclamation sereine a quelque chose de saisissant. Je n’en garde qu’un cri d’effroi, devant un trop tôt, qui fut celui d’Horace et de Virgile : «Etre né dans un monde où le Christ n’est pas encore venu : quelle inimaginable solitude ! »
Désormais, je n’aimerai plus Horace sans lui associer Xavier Patier. (La Table Ronde, 160 p., 7 €)