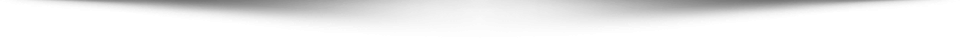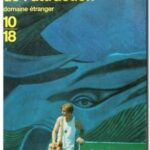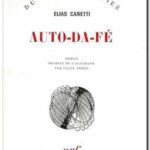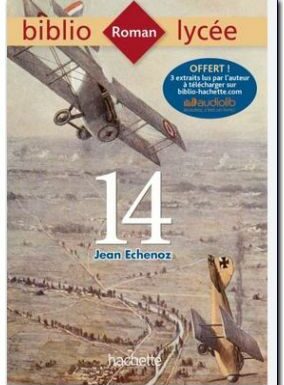
Le roman 14 est aussi court que la première guerre mondiale (qui aurait dû l’être) fut longue : un exploit littéraire.
Il fallait en effet oser reprendre ce fil maintes fois tiré, fil qui s’allonge au rythme d’une langue toujours aussi époustouflante et précise, et le pari est pour moi réussi. Grâce à une distanciation efficace, à un humour le plus souvent noir (doucement ironique, pas cynique). Grâce également aux descriptions minutieuses (comme toujours) des caractères, des marques, des armes, des corps, des insectes et des animaux, des avions de guerre, des objets abandonnés dans les villages traversés, des paquetages, des chaussures mais aussi de la somatisation, de la souffrance et de la mort.
Echenoz finit non pas par décrire ce qu’a été cette guerre (d’autres l’ont fait) mais, d’une provocante pichenette, par nous emmener dans l’après-guerre ou plutôt sur ce que la guerre a provoqué comme conséquences sociales, physiques et psychiques, notamment à travers une histoire sociale et sentimentale à la fois flaubertienne (ça sent le milieu bourgeois de province) et tchekhovienne (le trio amoureux). Car, ici, tandis que cinq jeunes vendéens (les frères Anthime et Charles, Padioleau, Bossis et Arcenel) sont mobilisés dans les Ardennes, de l’autre côté, une femme enceinte (Blanche) attend le retour de l’un d’eux. On ne dira rien de plus de cette histoire. On préférera vous faire profiter d’un moment faussement calme puisqu’il précède la tempête guerrière : les premières lignes de ce texte.